Près de trois mois après avoir instauré un plafond strict sur le nombre d’étudiants étrangers admissibles à une formation dans la province, le gouvernement du Québec revoit légèrement sa copie. Un nouveau décret, publié cette semaine dans la Gazette officielle du Québec, apporte quelques ajustements ciblés, notamment pour corriger des oublis et incohérences, sans toutefois modifier en profondeur la stratégie gouvernementale de réduction de l’immigration temporaire.
Le décret initial, dévoilé en février, avait soulevé un tollé parmi les établissements d’enseignement supérieur, surpris par des restrictions annoncées en fin de cycle d’admission. En réaction, Québec a désormais relevé de 371 le nombre total de certificats d’acceptation du Québec (CAQ) autorisés pour la période du 26 février 2025 au 26 février 2026. Rappelons que le CAQ est indispensable pour qu’un étudiant étranger puisse par la suite déposer une demande de permis d’études auprès du gouvernement fédéral.
🎓 Recevez infos exclusives + accès aux webinaires Q&R

Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine :
- Les dernières nouvelles sur l’immigration au Canada
- Des invitations à nos webinaires (questions/réponses en direct)
- Des outils pratiques pour réussir votre projet d’installation
Le nouveau décret vise principalement à rectifier certaines erreurs d’attribution observées dans la première mouture. Le cas des Conservatoires de musique et d’art dramatique du Québec, qui s’étaient vu attribuer seulement trois places malgré la présence de 28 étudiants internationaux en cours de formation, en est un exemple marquant. Certaines formations s’étaient même vu accorder des quotas pour des diplômes inexistants.
À l’opposé, d’autres critiques — notamment celles exprimées par les universités québécoises — n’ont pas été entendues. Le plafond global attribué aux universités est même revu à la baisse de 26 places, malgré l’importance de ces établissements dans la stratégie d’attraction et de rétention des talents internationaux.
Les chiffres font sourciller : le Collège supérieur de Montréal se voit attribuer près de 9000 places, contre un peu plus de 5000 pour l’Université McGill, pourtant l’une des institutions les plus prestigieuses du pays. Cette répartition a été vivement critiquée, notamment par la Fédération des cégeps, qui dénonce une punition injustifiée imposée au réseau public, alors que les « dérives » commerciales des collèges privés étaient dans la ligne de mire du gouvernement.
L’argument du ministère : ces quotas sont établis à partir des volumes d’étudiants internationaux recensés en 2024. Une méthode qui peut sembler technique, mais qui aboutit à une répartition jugée par plusieurs comme arbitraire.
La hausse la plus significative touche les diplômes d’études collégiales (DEC) et les attestations d’études collégiales (AEC), avec respectivement 163 et 224 places supplémentaires. Ces programmes, en particulier les AEC qualifiés de « voies rapides » vers la résidence permanente par la ministre Pascale Déry, étaient pourtant dans le viseur du gouvernement.
Le Collège O’Sullivan de Québec, initialement limité à une seule place, bénéficie désormais de 152 places supplémentaires. Les cégeps de Saint-Félicien, Marie-Victorin, Victoriaville et Gaspésie et des Îles voient aussi leurs quotas rectifiés, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.
Selon le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), ces plafonds auront un impact financier majeur. Les universités québécoises anticipent un manque à gagner d’environ 200 millions de dollars d’ici 2026. Les établissements privés, quant à eux, pourraient perdre jusqu’à 48 millions, selon les projections gouvernementales.
Ces pertes surviennent alors que les établissements comptaient sur les frais de scolarité des étudiants étrangers pour compenser les réductions de financement public et pour maintenir la qualité de leur offre académique.
Les étudiants étrangers constituent environ un immigrant temporaire sur cinq (21 %), selon les données de Statistique Canada. Une fois leurs diplômés en main, ils forment aussi l’un des contingents les plus importants de travailleurs étrangers sous le Programme de mobilité internationale (PMI).
Source : Le Devoir






















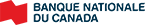



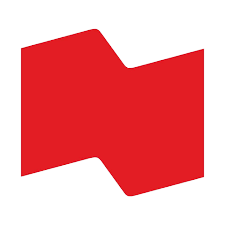
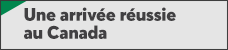
Bonjour je me nom NOHON OULARO ADRIENNE je suis ivoirienne je parle le français je veux immigré au Canada pour servir le peye je suis ponctuelle et courrajeuse merci de vouloir me répondre.
Faites un peu l’effort d’écrire sans faute d’orthographe surtout que vous voulez vous faire remarquer.