En ce lendemain de fête des pères au Canada et dans plusieurs pays du monde, nous voulions souligner les grandes lignes des dernières données sur la transformation des pères immigrants dans leur nouveau pays d’accueil. En effet, derrière les défis d’intégration souvent méconnus, émerge une paternité transformée, engagée et profondément investie.
Environ 80 % des pères immigrants ont été sélectionnés pour leurs compétences professionnelles, répondant aux besoins de main-d’œuvre du Québec. Pourtant, une fois sur place, beaucoup déchantent. « Ils ont l’impression d’être attendus comme travailleurs qualifiés, mais découvrent une réalité marquée par le sous-emploi et la précarité », explique Christine Gervais, professeure à l’UQO et codirectrice scientifique de l’Institut universitaire SHERPA.
🎓 Recevez infos exclusives + accès aux webinaires Q&R

Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine :
- Les dernières nouvelles sur l’immigration au Canada
- Des invitations à nos webinaires (questions/réponses en direct)
- Des outils pratiques pour réussir votre projet d’installation
Selon les données regroupées par le Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), 63 % des pères immigrants détiennent un diplôme universitaire — presque le double des pères nés au Canada (34 %). Malgré cela, 26 % d’entre eux vivent dans des ménages à faible revenu, contre 8 % chez leurs homologues québécois.
La non-reconnaissance des diplômes étrangers pousse nombre de ces pères à occuper des emplois précaires, loin de leur champ de compétence. Ingénieurs ou médecins dans leur pays d’origine, ils deviennent concierges ou employés de service à la clientèle pour subvenir aux besoins de leur famille.
Ce déclassement s’accompagne souvent de deuils : perte de statut professionnel, éloignement de la famille élargie, rupture avec les repères culturels. « Le Québec attire avec des promesses qui ne se réalisent pas toujours », constate Christine Gervais. « Le choc est grand, surtout lorsqu’on réalise que les obstacles sont nombreux et les soutiens, limités. »
Malgré ces difficultés, les données révèlent un fait étonnant : les pères immigrants sont deux fois plus nombreux à tirer une grande satisfaction de leur rôle parental que les pères québécois (42 % contre 21 %). Leur implication familiale semble aussi mieux perçue : 66 % d’entre eux estiment recevoir un soutien élevé de leur conjointe (vs 51 %), et 57 % disent être rarement ou jamais critiqués par cette dernière (vs 52 %).
Pourquoi ce paradoxe ? « Avoir réussi à emmener ses enfants au Québec est perçu comme une victoire en soi. Le plus dur est derrière, et être parent devient une fierté », analyse Gervais.
L’absence du réseau familial pousse souvent les couples à devenir une véritable équipe. Sans grands-parents ou proches pour les soutenir, les rôles traditionnels évoluent rapidement. Les pères prennent en charge des aspects autrefois dévolus aux femmes dans leurs pays d’origine : aide aux devoirs, trajets scolaires, soins quotidiens.
« Pour les femmes, c’est un changement profondément positif », souligne Gervais. « Elles découvrent un partenaire plus impliqué, ce qui renforce la cohésion familiale. »
source : Noovo






















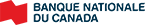




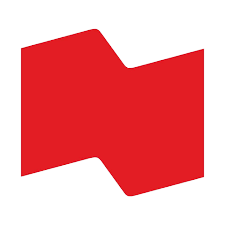
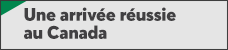
Wan motuman nu rakisef gara keessaniiti godard Barbara nii rakane malo nu gargara
Wan motuman nu rakiisef lubbun jirachuf gar keessan dhufu barabane malo nu biiramadha isiinin jana kabajamo